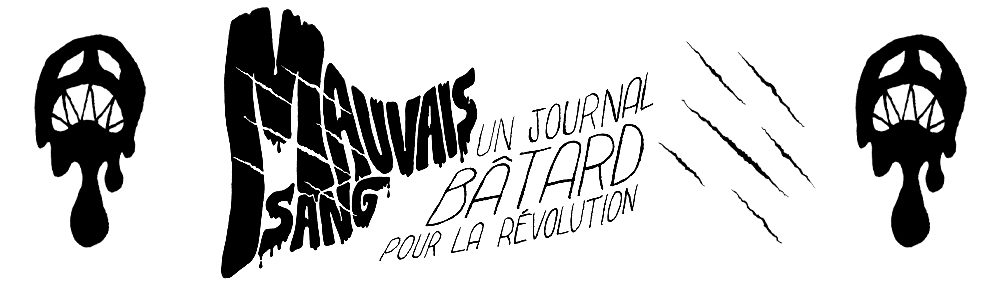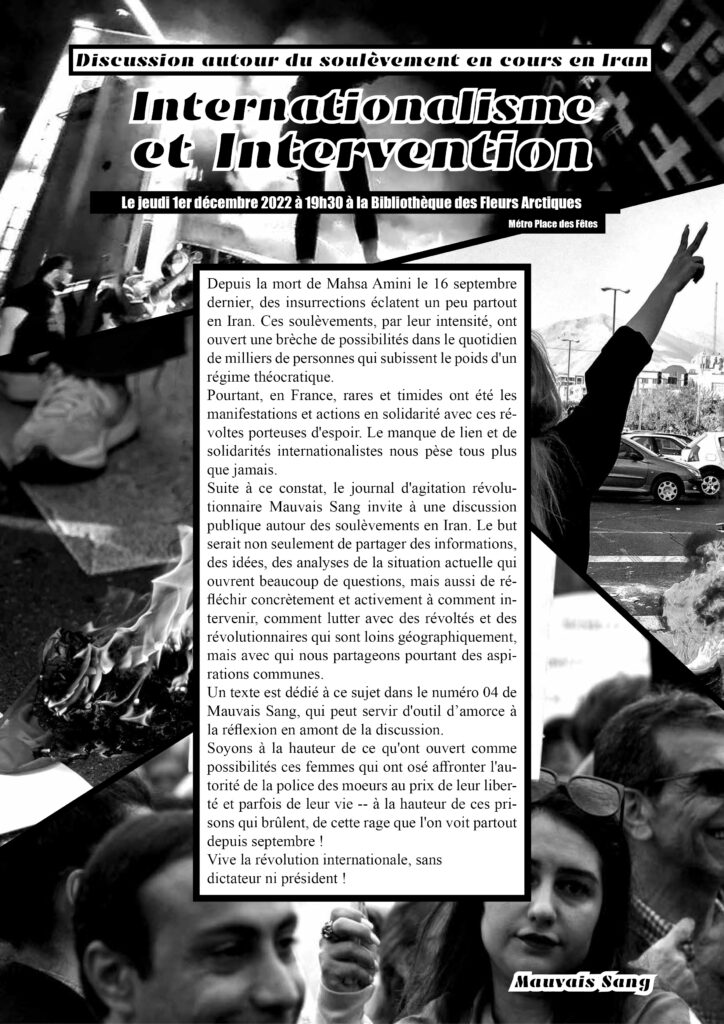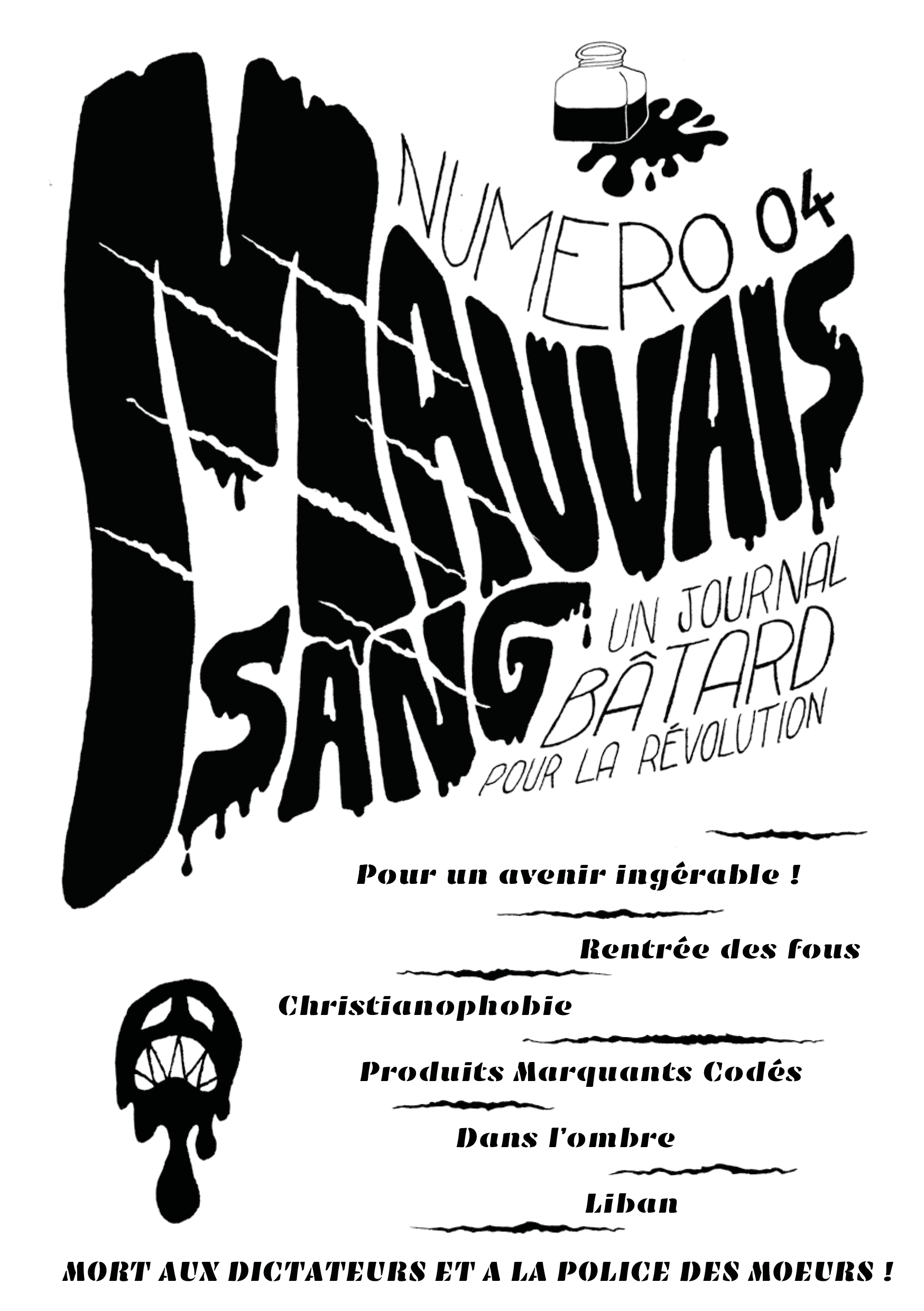Jamais autant de temps ne s’est écoulé depuis la formation de l’univers. Jamais autant de temps ne s’est écoulé depuis nos naissances. Nous n’avons jamais été aussi vieux.
Nos morts, certaines, n’ont jamais été aussi proches de nous. La révolution, incertaine, qui renversera tout, où éclatera la vie, où s’ouvriront mille possibles, si elle existera, n’a jamais été aussi proche de nous.
Nos vies ne peuvent que s’allonger, le temps passé dans la résignation ne reviendra jamais, ce sera à jamais un temps où l’on s’est tué au travail, où l’on s’est plié en quatre pour essayer de vivre dans un monde qui ne cherche qu’à nous rendre plus productifs. Nous n’avons pas tout notre temps à gâcher dans une mort lente dans ce monde.
Il y a une urgence quotidienne à tout envoyer chier. Il y a une urgence révolutionnaire.
Quelques gestes d’hygiène pour se protéger au comico : ne parlons pas aux flics, refusons la signalétique !
Récemment, la police s’est vue augmentée d’un nouveau moyen pour prélever les empreintes des gens lors des gardes à vue : une loi l’autorisant dans certains cas à exercer une contrainte physique pour effectuer la prise d’empreinte. Cette loi permet de généraliser le fichage des empreintes et d’éviter que les gens refusent de donner leur signalétique : une pratique répandue dans les milieux militants comme ailleurs. Nous avions consacré un article à cette question dans le numéro 3 de Mauvais Sang, disponible entre autres sur notre site internet (mauvaissang.noblogs.org). D’autres textes, facilement trouvables sur Internet, analysent le texte de loi ou font part d’expériences de prises d’empreintes forcées.
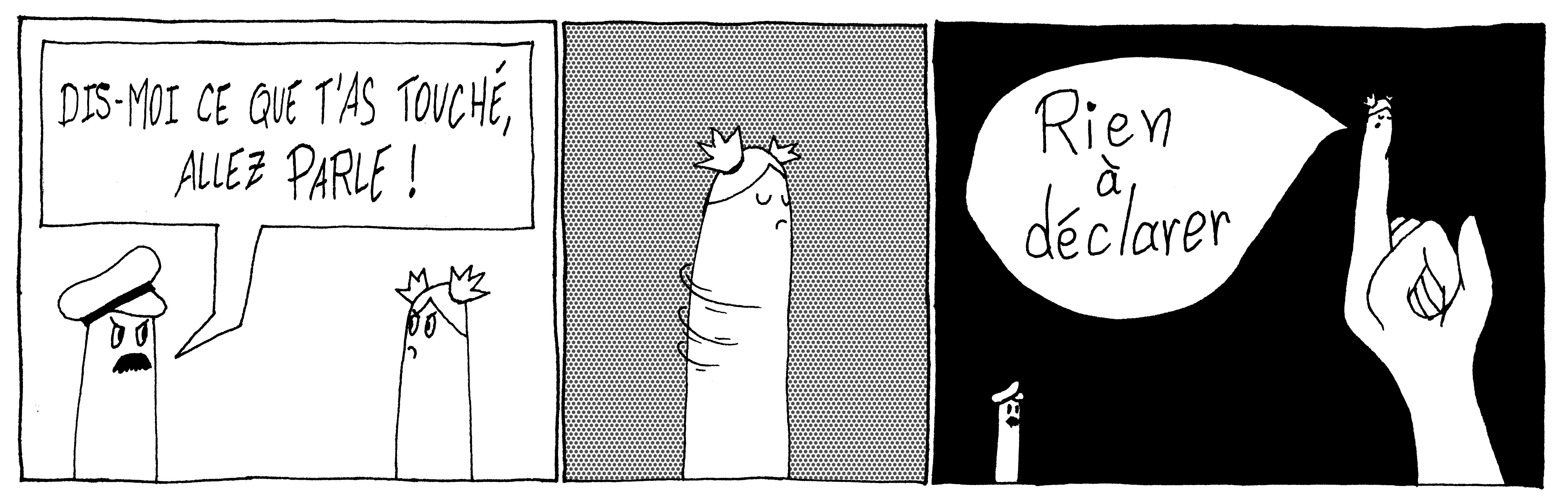
Une chose est essentielle à comprendre : la police n’a pas intérêt à réellement «forcer» la prise d’empreinte. Parce que prendre la main de quelqu’un qui résiste, lui ouvrir les doigts, appuyer sur l’encrier, et ensuite bien dérouler les doigts sur la pauvre feuille A4 fragile comme tout, c’est très facilement raté, mal fait, ou inexploitable. C’est pourquoi la police a en réalité besoin de notre pleine collaboration, qui, elle, peut être obtenue en amont sous la contrainte et qui est là pour faire peur, entre la menace physique et la menace judiciaire. L’objectif de la garde à vue n’est pas nouveau, c’est de faire mal et de faire peur, pour obtenir les aveux. Simplement ici, pas ceux de la bouche, mais ceux des doigts.
Il est donc essentiel de continuer à refuser de donner ses empreintes et son ADN en garde à vue, même si de nouvelles lois pèsent sur nous. C’est une pratique qui aide à se protéger individuellement et collectivement et qui ne doit pas être abandonnée. Cette loi de prise d’empreinte sous la contrainte fait peur, car elle est nouvelle et floue : nous tâtonnons, les flics aussi. Plein d’histoires autour de nous montrent bien qu’ils ont parfois la flemme de prendre les empreintes de force et se servent de cette menace pour faire avancer la procédure plus rapidement. Ça vaut toujours le coup de savoir jusqu’où ils peuvent aller, quitte à finir par les donner au dernier moment. Nous avons encore une marge de manœuvre. Le cirque des flics en garde à vue, c’est souvent de la posture pour faire asseoir leur autorité : du spectacle qui se dégonfle parfois rapidement, surtout quand l’ambiance dans les cellules est particulièrement combative. N’oublions jamais que les flics sont des gens très cons, et que leur taf, c’est quand même faire réchauffer du riz au micro-onde et porter des pantalons trop serrés.
Restons solidaires et continuons à maintenir une conflictualité, dans la rue, au comico, au tribunal !
Internationalisme et Intervention
Discussion autour du soulèvement en cours en Iran
Depuis la mort de Mahsa Amini le 16 septembre dernier, des insurrections éclatent un peu partout en Iran. Ces soulèvements, par leur intensité, ont ouvert une brèche de possibilités dans le quotidien de milliers de personnes qui subissent le poids d’un régime théocratique.
Pourtant, en France, rares et timides ont été les manifestations et actions en solidarité avec ces révoltes porteuses d’espoir. Le manque de lien et de solidarités internationalistes nous pèse tous plus que jamais.
Suite à ce constat, le journal d’agitation révolutionnaire Mauvais Sang invite à une discussion publique autour des soulèvements en Iran. Le but serait non seulement de partager des informations, des idées, des analyses de la situation actuelle qui ouvrent beaucoup de questions, mais aussi de réfléchir concrètement et activement à comment intervenir, comment lutter avec des révoltés et des révolutionnaires qui sont loins géographiquement, mais avec qui nous partageons pourtant des aspirations communes.
Un texte est dédié à ce sujet dans le numéro 04 de Mauvais Sang, qui peut servir d’outil d’amorce à la réflexion en amont de la discussion.
Soyons à la hauteur de ce qu’ont ouvert comme possibilités ces femmes qui ont osé affronter l’autorité de la police des mœurs au prix de leur liberté et parfois de leur vie – à la hauteur de ces prisons qui brûlent, de cette rage que l’on voit partout depuis septembre !
Vive la révolution internationale, sans
dictateur ni président !
Le jeudi 1er décembre 2022 à 19h à la bibliothèque des Fleurs Arctiques (45 rue du Pré Saint-Gervais, Métro Place des Fêtes).
Mauvais Sang numéro 4 / Pour un avenir ingérable !
Le temps où les différents chefs d’Etat, d’entreprises et de partis promettaient un capitalisme de croissance et de progrès social et technique pour justifier l’exploitation sordide de nos existences semble à présent révolu. Inflation, crise, pénurie, restrictions et sobriété sont les nouveaux mots d’ordre pour conjurer tout avenir qui bifurquerait de la route déjà tracée par la bourgeoisie : celle de la production incessante d’un monde autoritaire et marchand. Désormais le capitalisme se justifie à l’aune de la catastrophe permanente qu’il faudrait éviter, tous ensemble, avec patriotisme et soumission. Ainsi, le 5 septembre, Macron a fait un copier/coller de la gestion de crise sanitaire pour démarrer en bruit la gestion de crise énergétique. Virus ou gaz, du point de vue inhumain du capital, c’est du pareil au même : du risque, du chiffre, des stats, de la population et un même impératif, celui de faire perdurer dans la pacification et la résignation les institutions économiques et politiques. L’hiver va être dur, chers compatriotes ! Maintenant qu’il est devenu «normal» de transmettre le covid, d’en souffrir voire d’en crever, les points technocrates hebdomadaires ne porteront plus sur cette pandémie faussement conjurée, mais sur cette crise énergétique qui tracasse davantage le gouvernement. En effet, la raréfaction des énergies et l’augmentation de leurs prix causent leurs lots de soucis au capital lorsqu’ils font irruption de manière ingérable : la contestation sociale pointe son nez, tel qu’actuellement dans de nombreux pays jusqu’aux frontières de la France, en Angleterre, et c’est cela qu’il s’agit avant tout d’éviter. Au travail ! Un petit chèque de cent balles en septembre pour faire copain copain. Dans le discours de Macron, c’est la COUPURE qu’il faut absolument éviter. La COUPURE, ce nouveau monstre qui doit s’agiter la nuit dans les esprits anticipateurs des technocrates, remplace ainsi le «confinement général» qui jouait le même rôle de risque suprême fut un temps, car les deux formes de gestion ont en commun d’apparaître à un moment T comme le dernier des derniers outils étatiques, qui entraînent leurs lots de complexités tels qu’un changement brusque et soudain dans le quotidien, propices à de l’immaîtrisable. Alors pour éviter ce grand inconnu gestionnaire, le Risque Suprême de notre hiver, il s’agit de construire une peur tout autour – nous sommes en guerre ! Mobilisation générale ! Sauvons la Fée Electricité ! – qui n’a pour seule solution que de nous conduire de plans de restrictions en plans de restrictions. Derrière l’argumentaire «Si tout le monde baisse volontairement sa conso d’énergie, on évitera la phase contrainte», le gouvernement prépare déjà ses possibilités gestionnaires. Comme cela avait été le cas après les explosions de cas de covid suite aux rentrées scolaires et aux retours au travail, le gouvernement pourra expliquer, lors d’une phase 2 qui aura son lot de nouvelles contraintes et d’autoritarisme, que c’est la faute des concitoyens aux mauvaises manières, qui n’auront pas suffisamment pratiqué les mots d’ordre de la «sobriété volontaire». Comme en Angleterre, va-t-on nous inciter à travers les journaux à cuisiner au micro-onde plutôt qu’au four ? Miam. Avec cette nouvelle gestion de crise, l’Etat tente encore une fois d’embourgeoiser les consciences malheureuses pour que chacun, même dans la pire situation matérielle, se sente investi d’une haute mission morale : celle de COMPTER, de pratiquer au niveau individuel la petite rentabilisation, la petite joie malsaine de se comporter dans la vie comme un compteur linky (et peut-être de dénoncer son voisin qui prend trop de bains ?). Tout irait tellement mieux si tous les êtres humains, dès l’enfance, se comportaient dans la vie comme des participants à un grand jeu de gestion dont ils ne sont évidemment pas les héros, mais les tous petits rouages bien soumis !
Mais voilà, cette moralité de petit comptable nous donne la gerbe, et l’envie de mettre l’économie à sac ne cesse de croître, pour un avenir totalement ingérable !
Nique l’Etat, nique EDF, nique les micro-ondes et toute la bourgeoisie qui facture nos vies.
Il est possible de nous contacter par mail, que ce soit pour entrer en conflit, pour poser des questions ou autres contributions. Il est aussi possible que nous vous contactions, que ce soit pour entrer en conflit, pour poser des questions ou autres contributions.
Des enfants bâtards de l’anarchisme et du communisme
Rentrée des fous
Les syndicats, lécheurs de botte du pouvoir dans absolument tous les pays, n’ont pas hésité une seule seconde en Angleterre à s’aplatir devant la mort d’une vieille bigote chrétienne du nom d’Elizabeth II, alors qu’ils étaient en pleine grève massive depuis la fin du mois d’août. Hop hop hop, deuil national, comme si les révoltes qui grondent contre le coût de la vie devenu insoutenable devaient s’arrêter devant le seuil du pouvoir et de la royauté pour permettre de grands banquets paisibles aux héritiers du Vieux Monde et de l’ordre pourri. Mort au roi, mort à la reine, mort aux capitalistes et puis surtout, mort aux syndicats, qui n’auront pas hésité à appeler à la lâche trêve. On espère bien que la lutte outre-manche contre la vie chère et misérable ne va pas aller en s’arrangeant, et qu’elle aura tôt fait de menacer de s’étendre, et peut-être même, de dégénérer…
Avant de larmoyer « La paix sociale sous deuil national est de retour ! », le secrétaire général du syndicat Maritime and Transport déclarait « La classe ouvrière est de retour ! ».
A-t-elle un jour disparu ? Le prolétariat se constitue dans la lutte. A-t-il jamais cessé de trimer, de lutter ? Pour que la lutte s’approfondisse, il est plus que vital que ce mouvement social déborde et échappe aux logiques de l’organisation syndicale !
Vite, que le règne de Charles III et de ses amis les syndicats se termine sous les feux de la lutte !
Moi aussi, j’ai bien envie de ne pas aller à l’école, de ne pas aller travailler, de ne pas payer de loyer, de ne pas payer mes factures, de ne plus rien payer du tout. La vie est trop courte pour baisser ma lourde tête devant la lourde bêtise des professeurs et des patrons. À la rentrée, je veux faire la sauvageonne dans la rue, et comme il me plaira, n’en déplaise aux syndicats qui, toujours, encadrent, empêchent, négocient.
Ne travaillons plus, ne payons plus : dans la rue ! La vie est trop courte !
OUI ! OUI ! Une rentrée des fous, s’il vous plaît
Il y en a marre de la rentrée des classes. Voilà l’autoproclamation de la création d’un autre temps, qui ne soit ni celui de l’école, ni celui du travail, mais celui des manifs ! L’autoproclamation des temps des révoltes et des sorties des classes. Pour que toutes les voix cassées par le capitalisme, par les autorités et les élites, sortent des bancs des classes bien rangées !
Pour la sortie des classes, de toutes les classes, sociales, scolaires, biologiques et pour la rentrée des fous-les !
Cette année à la rentrée, c’est non aux maîtres, aux bienfaiteurs, aux protecteurs, aux autorités, aux dictateurs de la bonne pensance, à l’apprentissage forcené et aliénant et surtout non aux leçons longues et infernales qui se répètent et qui donnent la nausée. Voilà l’autoproclamation d’une rentrée de l’assemblage des forces en lutte et de l’accouchement d’émancipations nouvelles.
Contre les savoirs qui s’accumulent et qui pourrissent dans les universités, les écoles et les lycées. Tous les savoirs vides et poussiéreux qu’on apprend par cœur sans bien savoir pourquoi. Mais aussi tous les cachets qu’on va prendre pour oublier la routine étouffante, le conditionnement organisé qui nous envoie la tête baissée au métro, au travail, qui nous vident la tête et le corps, qui vident de tout rayon de joie et tout rayon de vie.
A la rentrée, je dirai non avec la tête, je ne parlerai pas d’autre langue que celle de Prévert !
Déjà marre des demis dieux de profs qui ne font que s’écouter parler. Déjà marre du travail, de la machine à café, des bibliothèques. Marre par avance des employeurs, des mêmes gestes, de toutes ces semaines à venir de trajets répétés, des compétitions pour la meilleure note ou pour le meilleur poste. Nous voulons la création d’un autre temps, qui ne soit ni celui de l’école, ni celui du travail mais celui des manifs, des ag et de la rue, le temps marqué par toutes les grèves et tous les incendies possibles ! Ce qu’il reste de vie, en classe, ou au travail : reprenons les ! Ce qu’il reste de rentrée, ce qu’il reste de vie, n’est que lutte, n’est que révolte !
« On se rend maintenant très bien compte, à l’aspect du travail – c’est-à-dire de ce dur labeur du matin au soir – que c’est là la meilleure police, qu’elle tient chacun en bride et qu’elle s’entend vigoureusement à entraver le développement de la raison, des désirs, du goût de l’indépendance. Car le travail use la force nerveuse dans des proportions extraordinaires, et la soustrait à la réflexion, à la méditation, aux rêves, aux soucis, à l’amour et à la haine, il place toujours devant les yeux un but minime et accorde des satisfactions faciles et régulières. Ainsi, une société où l’on travaille sans cesse durement, jouira d’une plus grande sécurité : et c’est la sécurité que l’on adore maintenant comme divinité suprême ».
Nietzsche
Christianophobie
En juin dernier de l’an de grâce 2022, la Cour suprême des Etats-Unis a permis à ses états membres d’interdire l’avortement, ce qui a immédiatement été appliqué au Missouri, fer de lance de la lutte contre le fléau hérétique que cette pratique représente. En Espagne, terre de foi et de piété, des manifestations « pour la vie » ont été organisées en soutien à cette décision, s’opposant à la prochaine réforme du gouvernement socialiste en la matière. En France, récemment, un jeune s’est fait condamner par la justice pour « préjudice moral », pour avoir bougé en rythme son fessier (ainsi jugé aguichant et tentant par les autorités pénales et religieuses) au sein d’une église. Il subira également un harcèlement méticuleux de la part de quelques religieux blessés (et donc, quelque part, tentés) et autres nostalgiques de l’époque de l’Inquisition catholique. Loin de provoquer notre indifférence, ce climat de sainteté nous pousse (peut-être sous la pression du Malin) à rappeler quelques faits notoires : Dieu est mort, la Vierge aurait peut-être mieux fait d’avorter et Jésus n’était qu’un barbu parmi tant d’autres. « Blasphème ! Hérésie ! Christianophobie ! Enfer ! ». Doit-on aussi rappeler que l’Enfer et le Paradis ne sont que des épouvantails servant à effrayer les gens qui les regardent ?
Dieu est une belle saloperie, qui aura coûté la vie et la liberté de plus de gens qu’il n’est possible de se le représenter. Et il faudrait s’interdire de lui cracher à la gueule, au nom de gens qui mettent leur conscience entre nos crachats et son divin visage ?
Si Dieu est intouchable à cause du fameux respect du prochain, qu’en est-il de la nation que nous souhaitons si chèrement abattre ?
Produits Marquants Codés
Les techniques de surveillance et de répression ne cessent de se perfectionner. Depuis les miradors, l’éclairage public, le bertillonnage, le pointage, la carte d’identité, la graphologie, le polygraphe, les empreintes digitales, l’ADN, la reconnaissance de l’œil, les caméras de vidéosurveillances, les badges, la reconnaissance faciale, les détecteurs de bruits anormaux, les drones, rien n’arrête la Smart City, l’avenir de toutes les grandes métropoles si nous n’y faisons rien. Pour compléter cet arsenal répressif déjà bien étoffé, la police peut compter sur les centaines de start-ups qui travaillent dur pour trouver de nouveaux moyens de faire peur et de mater toute révolte. Une des dernières expérimentations se trouve du côté du maintien de l’ordre, mais déjà utilisée depuis plusieurs années contre les cambriolages de commerces. Les Produits Marquants Codés (PMC) sont des produits chimiques invisibles à l’œil nu, inodores, et non toxiques qui sont utilisés pour marquer des individus à un moment où il n’est pas possible de les arrêter, et de les contrôler quelques heures ou quelques semaines plus tard (suivant le type de PMC), prouvant par la trace de ce produit, visible à la lumière UV, la présence d’une personne à un endroit et à un moment. Cette technologie anticasseurs, appliquée aux manifestations, était déjà promise par le ministre de l’intérieur Christophe Castaner en mars 2019 face à l’explosion du mouvement des gilets jaunes. Bien sûr, l’Assemblée nationale précise qu’il s’agit d’un produit qui ne peut être utilisé « que sur des manifestants commettant des délits ». Etant donné le moyen, parfois les canons à eau ou les gaz lacrymogènes, cela signifie donc que les flics peuvent décider qu’une partie entière est composée de délinquants, et que l’autre non. La direction nationale de la gendarmerie précisait, en 2021, dans le rapport de l’Assemblée Nationale, que « des études sont actuellement en cours quant à l’utilisation des produits de marquage codé au rétablissement de l’ordre, via un marqueur à distance individualisant longue portée, capable de tirer des billes frangibles de PMC ». C’est certainement ce qui a été vu utilisé en mars 2022 par les gendarmes lors des manifestations dans les Deux-Sèvres contre le projet des méga-bassines, sous la forme de balles type paintball. Utilisé aussi, le même mois, en Corse durant les manifestations suite à la mort d’Yvan Colonna, sous forme de spray.
La peur de la répression fait partie de la répression. Savoir que l’on est surveillé tend à nous paralyser. Les PMC, visibles nous rappelle qu’on est dans le viseur de la police. Les marqueurs invisibles, qui ne prouvent pas un délit mais seulement la présence d’une personne à un endroit, participent aussi à la peur puisque, éventuellement, dans chaque gaz lacrymogène peut se cacher un marqueur, visiblement.
La colère qui gronde ne sera pas arrêtée par des outils techniques. L’intelligence collective d’une émeute, d’un mouvement social, peut mettre à terre tous les drones, peut percer toutes les lignes de flics, détruire tous les palais de justice, rendant ces gadgets inutilisables de fait.
Dans l’ombre
LE VIEUX MONDE
 Ô flot, c’est bien. Descends maintenant. Il le faut.
Ô flot, c’est bien. Descends maintenant. Il le faut.
Jamais ton flux encor n’était monté si haut.
Mais pourquoi donc es-tu si sombre et si farouche ?
Pourquoi ton gouffre a-t-il un cri comme une bouche ?
Pourquoi cette pluie âpre, et cette ombre, et ces bruits,
Et ce vent noir soufflant dans le clairon des nuits ?
Ta vague monte avec la rumeur d’un prodige
C’est ici ta limite. Arrête-toi, te dis-je.
Les vieilles lois, les vieux obstacles, les vieux freins,
Ignorance, misère et néant, souterrains
Où meurt le fol espoir, bagnes profonds de l’âme,
L’ancienne autorité de l’homme sur la femme,
Le grand banquet, muré pour les déshérités,
Les superstitions et les fatalités,
N’y touche pas, va-t’en ; ce sont les choses saintes.
Redescends, et tais-toi ! j’ai construit ces enceintes
Autour du genre humain et j’ai bâti ces tours.
Mais tu rugis toujours ! mais tu montes toujours !
Tout s’en va pêle-mêle à ton choc frénétique.
Voici le vieux missel, voici le code antique.
L’échafaud dans un pli de ta vague a passé.
Ne touche pas au roi ! ciel ! il est renversé.
Et ces hommes sacrés ! je les vois disparaître.
Arrête ! c’est le juge. Arrête ! c’est le prêtre.
Dieu t’a dit : Ne va pas plus loin, ô flot amer !
Mais quoi ! tu m’engloutis ! au secours, Dieu ! la mer
Désobéit ! la mer envahit mon refuge !
LE FLOT
Tu me crois la marée et je suis le déluge.
Victor Hugo
MORT AUX DICTATEURS ET A LA POLICE DES MŒURS !
Depuis la mort de Mahsa Amini, les femmes en Iran brûlent leurs voiles, dévoilant au monde entier le beau spectacle d’individus révoltés. Arrêtée pour un de ces prétextes arbitraires dont la Gasht-e-Ershad (police des mœurs chargée d’appliquer entre autres les règles de tutelle religieuse des femmes) est coutumière, la jeune femme a subi des mauvais traitements qui l’ont tuée. Il ne s’agit pas d’une simple affaire de « bavure policière ». Des manifestations ont lieu à Saqqez, à Sanandaj, mais aussi à Téhéran, et dans une quarantaine d’autres villes depuis cinq nuits de suite. Partout on entend “Mort à la République islamique !”,“Mort au dictateur !”. Sa mort intervient dans un contexte de répression générale qui pèse sur tout l’Iran. Elle est la goutte d’eau qui fait déborder la colère sociale s’étant exprimée toutes ces dernières années.
 Plusieurs mouvements de contestations ont eu lieu depuis la réélection (truquée) d’Ahmadinejad en 2009. Mais c’est avec l’élection (truquée là encore) de Rohani et les mesures d’austérité qui l’ont accompagnée en 2017 que les mouvements de révoltesont pris un tour violent, malgré une tentative de la part de l’opposition officielle d’en prendre le contrôle. Ce sont des jeunes ouvriers et des chômeurs, ce sont des jeunes femmes luttant pour leur liberté qui se soulèvent non simplement contre les mesures du gouvernement, mais contre le régime théocratique et dictatorial lui-même.
Plusieurs mouvements de contestations ont eu lieu depuis la réélection (truquée) d’Ahmadinejad en 2009. Mais c’est avec l’élection (truquée là encore) de Rohani et les mesures d’austérité qui l’ont accompagnée en 2017 que les mouvements de révoltesont pris un tour violent, malgré une tentative de la part de l’opposition officielle d’en prendre le contrôle. Ce sont des jeunes ouvriers et des chômeurs, ce sont des jeunes femmes luttant pour leur liberté qui se soulèvent non simplement contre les mesures du gouvernement, mais contre le régime théocratique et dictatorial lui-même.
Deux ans plus tard, en 2019, les actions des révoltés ont pris l’allure d’une lutte arméeet en armes, avec des incendies de banque par tout le pays, des sabotages de raffinerie dans des contextes de grève sauvage et fait inédit – l’attaque de bases bassidjis (branche paramilitaire des « Gardiens de la Révolution islamique » (sic) placée directement sous l’autorité de l’ayatollah Khamenei). La répression a été féroce : 7000 arrestations d’individus dont on arrache des aveux sur leurs actions, 234 personnes tuées en tout, 3 500 blessés, 7000 personnes avaient été arrêtées. Le régime des Mollahs a envoyé sa police tirer sur les manifestants. Une fille âgée de dix ans a reçu une balle dans la tête à Bukan. Et le gouvernement a coupé Internet et instauré une censure vis-à-vis des médias extérieurs pour qu’on ne sache rien de tout ça…
C’est fort de toute cette colère, fortifiée d’ailleurs par les pénuries d’eau durant les étés (imputées à tort au réchauffement climatique par le gouvernement, alors qu’elle est le fait d’une « mafia de l’eau » composée de grands propriétaires qui la détourne massivement pour leur propre profit) et les pénuries alimentaires dans les diverses provinces, — c’est fort aussi de toute l’expérience de la répression que ce mouvement quinquennal de révoltes devient insurrectionnel aujourd’hui et laisse la police et l’armée momentanément désorganisée. Pour combien de temps ? D’autre part, si le mouvement est sans leader pour l’instant, la possibilité que des organisations en prennent le contrôle pour les plier à leur propre agenda politique n’est pas exclue.
Quelles sont les forces qui risquent de récupérer le mouvement ? Comment les endiguer ? Certaines organisations politiques nationalistes qui ont été écartées de la Révolution islamique de 1979 repointent le bout de leur nez, tel la CNRI/OMPI (Conseil National de Résistance iranienne composée pour l’essentiel des militaires sectaires de l’Organisation des Moudjahidines du Peuple Iranien). D’autres organisations, plus récentes, luttent en régionalistes face à l’ « occupant » iranien. Le KDPI (Parti démocrate kurde en Iran) et le Komala (parti social-démocrate) récemment alliés et en concurrence avec le PKK pour le projet d’une révolution dans la région qui aboutirait à un État fédéral et multi-confessionnel appellent à la lutte contre les forces de l’ordre iraniennes par tous les moyens.
En somme, c’est la tentation d’une révolution encore nationaliste qui pèse sur l’Iran, révolution qui se fera au détriment des révoltés de là-bas comme d’ailleurs — révoltés qui savent que la répression qu’ils subissent déjà et subiront inévitablement dans un tel contexte a peu à voir avec leur appartenance ethnique ou religieuse, tout comme les raisons qui les ont précipité sur les barricades à visage et chevelure découverts, la rage au ventre.
Quelles perspectives révolutionnaires pourraient se dessiner au sein de ces insurrections ?
Comment faire en sorte que ces incendies, ces actes de sabotage et de tabassage de flic trouvent un écho dans les autres pays, comme par exemple chez les libanais qui braquent les banques pour survivre ou les étudiants grecs qui manifestent pour que les condés n’aient pas place dans leur fac ? Comment faire en sorte que ce qui se passe en Iran ait un écho en France ? Ici, ça représente d’autant plus une gageure qu’on assiste à d’étranges atermoiements de la part de militants qui, par anti-impérialisme, s’abstiennent de dire quoi que ce soit sur la situation en Iran. Un silence assourdissant sur les mouvements de révoltes, rompu çà et là par de vagues allusions à l’insidieuse influence occidentale que subit le régime des mollahs et qui justifierait une certaine réserve… Bref, on rejoue la partition manichéiste et proto-complotiste d’un choix entre deux camps (grosso-modo Israël ou les USA vs l’Iran) en fermant délibérément les yeux sur un mouvement dont la spontanéité ne fait aucun doute.
Comment se solidariser avec ces femmes et ces hommes qui ont décidé de lutter contre leur quotidien et contre les pouvoirs en place sans tomber dans les pièges du manichéisme et du démocratisme ?
Car ici aussi, nous devons nous méfier de toute forme de récupération politicienne, qui ne voit dans ces soulèvements qu’une occasion de plus de sortir leur soupe stérile des fameux « débats sur voile » (qui ont lieu à gauche chez les meilleures féministes réformistes comme à droite chez les conservateurs réactionnaires).
Il est plus que nécessaire de réaffirmer et consolider une solidarité internationale et d’être à la hauteur de celles et ceux qui luttent en mettant leur vie et leur liberté en péril.
Vite ! Rencontrons-nous pour que ce mouvement en Iran ne soit ni isolé, ni asphyxié par les pouvoirs !
Afin qu’on ne puisse plus interposer entre les révoltés de tous les pays les voiles identitaire qui nous maintiennent dans l’ignorance de notre force collective et de la perspective internationaliste qui peut la rendre concrète,
SOLIDARITÉ TOTALE AVEC LES INSURGES ET MORT A LA THEOCRATIE IRANIENNE !
Sur le Liban
Texte reçu par mail
J’ai voulu écrire un texte sur Ô combien les libanais étaient des gens animés par un esprit révolutionnaire puis je me suis souvenue que cela fait désormais 4 ou 5 ans qu’ils ne peuvent accéder à leur argent et qu’il n’y a pas de mouvement de masse pour faire flamber toutes ces banques. 4 ou 5 ans que ponctuellement des gens cassent des vitres par-ci par-là pour avoir leurs thunes et une révolution en 2019 qui s’est essoufflée en quelques mois. La place du parlement est toujours barricadée comme si la révolution s’était déroulée hier ou comme si elle allait arriver demain. La place des martyrs pue la révolution mais pue aussi le vide. Elle est couverte de tag mais il n’y a personne. Le présent ici c’est le rien. Les gens suffoquent. Le feu de l’explosion sur port n’est toujours pas éteint. Les gens crèvent, ça pue la pollution et la fumée qui continue de s’échapper du port est toxique.L’atmosphère est tendu. Les gens sont coincés là, entre des villes chrétiennes, musulmanes et des villes tenues par le Hezbollah. Après quelques jours ici, ce que je vois ce sont des gens qui attendent une nouvelle guerre pour pouvoir se casser de cet enfer en obtenant un statut de réfugié politique. Ils sont à deux doigts de prendre des bateaux pour sortir d’ici. Ils sont au milieu d’un néant qui se consume sur lui-même mais une brindille qui prendrait feu pourrait vite devenir un brasier.