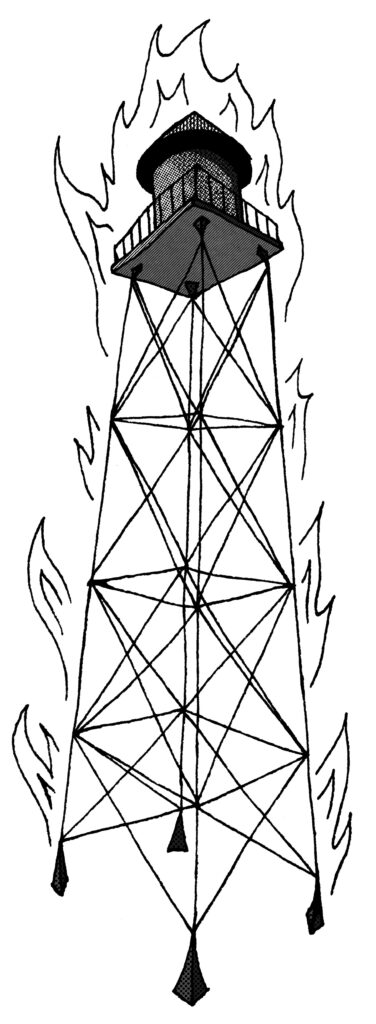Dans la nuit du premier mai 1991, vers 4h du matin, un groupe d’anonymes marche dans les couloirs du métro parisien. Ils s’en vont recouvrir, entre deux rondes de vigiles, la station considérée comme la plus belle de Paris, Louvre-Rivoli, sur la ligne 1 du métro. Elle abrite de nombreuses copies des statues antiques grecques et égyptiennes du musée du Louvre. Bien trop propre, créée pour faire de l’art une marchandise en vitrine, qu’on observe sans pouvoir toucher. Au goût de ces tagueurs, cet art manquait sans doute un peu de vie et a effectivement regagné toute sa puissance lorsqu’ils ont entièrement recouvert les murs et les statues de tags en tout genre. Notamment « Qui sème le vent récolte la tempête ! », clairement adressé à la RATP qui depuis la fin des années 80 en avait marre de voir ses stations et ses rames de métro recouvert de tags et venait quelques mois auparavant de lancer une grande campagne contre les dégradations. La création de nouveaux vigiles armés, les GIPR (Groupe d’intervention et de protection des réseaux), et la promesse de faire payer cher ceux qui profitent de la nuit pour redonner quelques couleurs au métro. Contrairement à aujourd’hui où ce genre d’annonce est devenu banal et ne donne lieu à aucun retour de flamme, il y avait dans le début des années 90, des personnes pour qui le graffiti n’était pas du street art qui cherchait à se faire une place dans les galeries d’art. C’était un mouvement intrinsèquement contestataire, lié au Hip-hop, et qui identifiait pertinemment l’ennemi des balades nocturnes colorées et de la liberté : la police, l’ordre, la sécurité, la propreté, le gentil citoyen. Le lendemain du crime, tous les médias se rendent sur place et l’on retrouve aujourd’hui encore des archives de ces reportages où les journalistes et les bourgeois du centre de Paris s’offusquent de ces bandes de barbares qui s’attaquent à notre patrimoine ! Malheureusement, un journaflic passionné par le monde du graff fait ses recherches et retrouve les trois personnes qui ont fait ces tags et sort un reportage qui sert aux keufs, après quelques temps de mises sur écoute et d’enquête, à les arrêter. Un mois de détention préventive, pour la punition, puis des peines de prisons avec sursis et des lourdes amendes. La RATP a ensuite installée progressivement des caméras dans les stations, puis dans les rames (jusqu’aux 50 000 caméras aujourd’hui qui quadrillent le réseau Bus/métro/RER). Heureusement l’année suivante, la station est à nouveau vandalisée.
La même année, en 1992 donc, dans une époque où la propreté semble être une obsession pour toutes ces bonnes gens, un groupe de scouts des Éclaireuses et Éclaireurs de France s’en vont faire leur bonne action de la journée. Marre de voir des murs sales, recouverts de graffitis en tout genre, eux préfèrent le béton bien lisse qui ne dit rien, les publicités, les affiches de campagnes électorales et les annonces de la mairie qui organise une fête des voisins super sympa samedi prochain ! Ils vont donc à 50 mètres de profondeur dans une grotte dans le Tarn-et-Garonne, la grotte de Mayrière supérieure, s’assurer qu’un vandale n’a pas osé dégrader la roche. Ils nettoient des graffitis noirs, qui s’avéreront être en réalité des peintures pariétales du Solutréen, au Paléolithique supérieur, représentant deux bisons magistraux sur deux mètres de long, découverts 40 ans auparavant. Peut-être peint par des Homo Sapiens qui, à la lumière de leur chandelle, bravaient l’interdiction de leur clan de peindre sur ces belles parois.
Il n’y a rien de plus mort et résigné qu’un mur blanc. Ils veulent rendre ce monde lisse et apathique et réserver l’Art aux Musées, au Génie Artistique et aux Grands Hommes, mais la beauté se trouve dans le conflit, dans la lutte, dans le refus, à la portée de tout le monde. La sécurité, l’ordre et la civilité sont des poisons, vive le vandalisme !

 De l’autre côté du Rhin, en novembre 2023, une réunion réunissait des pontes de l’extrême-droite allemande, autour du parti AfD et autres néo-nazis, pour parler projet de « remigration », incluant une expulsion des étrangers ainsi que des allemands d’origine étrangère. Le fantasme des militants Reconquête ou autres fachos ! L’annonce de cette réunion secrète, rendue publique, engendre une grande réaction de la part des partis démocrates qui ont appelé à de grandes manifestations. Bien sûr, ce genre de lois, si elles étaient appliquées, serait un gros bouleversement. Mais est-ce que ça n’aurait vraiment rien à voir avec ce monde de merde ? Pourquoi les mêmes partis politiques qui s’indignent en Allemagne sont peu ou prou les mêmes qui vont voter la loi Immigration en France ? En France, à quel point la loi Immigration va intensifier des dynamiques déjà présentes auparavant ? Il ne s’agit pas de minimiser ce qui s’est décidé, qui représente un pas nationaliste et xénophobe de plus, mais plutôt de voir en quoi il s’agit d’une continuation de la même volonté de contrôle, de gestion, de tri et de sécurité. Assimilation, intégration, insertion, ou expulsion : toujours le même vocabulaire pour voir dans l’altérité et l’étranger un ennemi, un danger.
De l’autre côté du Rhin, en novembre 2023, une réunion réunissait des pontes de l’extrême-droite allemande, autour du parti AfD et autres néo-nazis, pour parler projet de « remigration », incluant une expulsion des étrangers ainsi que des allemands d’origine étrangère. Le fantasme des militants Reconquête ou autres fachos ! L’annonce de cette réunion secrète, rendue publique, engendre une grande réaction de la part des partis démocrates qui ont appelé à de grandes manifestations. Bien sûr, ce genre de lois, si elles étaient appliquées, serait un gros bouleversement. Mais est-ce que ça n’aurait vraiment rien à voir avec ce monde de merde ? Pourquoi les mêmes partis politiques qui s’indignent en Allemagne sont peu ou prou les mêmes qui vont voter la loi Immigration en France ? En France, à quel point la loi Immigration va intensifier des dynamiques déjà présentes auparavant ? Il ne s’agit pas de minimiser ce qui s’est décidé, qui représente un pas nationaliste et xénophobe de plus, mais plutôt de voir en quoi il s’agit d’une continuation de la même volonté de contrôle, de gestion, de tri et de sécurité. Assimilation, intégration, insertion, ou expulsion : toujours le même vocabulaire pour voir dans l’altérité et l’étranger un ennemi, un danger.